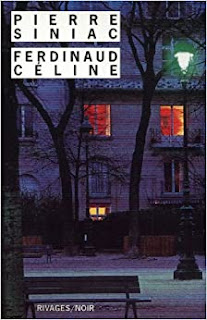La méprise
de Vladimir Nabokov
*****
Vladimir Nabokov avait 33 ans quand il a écrit la première version de « La méprise » qui avait alors un autre titre. Il était à Berlin et c’est là que ce roman fut publié pour la 1ère fois, tout d’abord en feuilleton (1934) puis en livre (1936). Plus tard, Nabokov le traduisit lui-même en anglais (titre Despair), puis en français (titre La Méprise). Vladimir avait des idées très précises et parfois originales sur la traduction d’œuvre littéraire et c’est ainsi que le titre se modifia d’une version à l’autre. D’autre part, lors des rééditions, l’auteur n’hésitait pas à apporter des modifications si bien que, comme il le dit lui-même, on peut, en comparant les trois éditions, trouver les différences, ajouts et retraits.
Quoi qu’il en soit, l’ouvrage commence ainsi : « Si je n’étais pas parfaitement sûr de mon talent d’écrivain et de ma merveilleuse habileté à exprimer les idées avec une grâce et une vivacité suprême… »
C’est assez donner le ton. L’histoire nous est racontée par un étrange personnage du nom de Hermann, incroyablement infatué de sa personne, partiellement fou, et profondément ridicule. On suit fasciné son incroyable récit, peinant parfois à croire qu’il ait vraiment pu avoir ce genre de raisonnement, mais y croyant quand même –grâce au considérable talent de Nabokov- hésitant tout au long entre le rire et la consternation. Je vous assure que Vladimir sait manipuler son lecteur et lui faire éprouver exactement ce qu’il veut quand il veut ; et quand on croit être assez malin pour deviner quelque chose par avance, c’est lui encore qui nous a glissé ce soupçon dans l’oreille. Mais je m’aperçois que je ne vous ai encore rien dit de l’histoire.
Ce «merveilleux écrivain» se lance donc d’entrée de jeu dans le récit de ce qu’il a vécu et nous quittons bientôt la chambre où il écrit pour le suivre sur d’autres scènes et alors là…
Par exemple, il commence par nous situer ses parents et son passé, et après à peine une page de cette mise en situation, il lâche négligemment « Une légère digression : dans ce passage concernant ma mère, j’ai menti de propos délibéré. »
Le ton est donné. Quand il ne se trompe pas totalement, ainsi que le lecteur le devine ou le soupçonne (mais encore pas assez), Hermann mêlera tant mensonges et réalité que personne ne saura bientôt plus exactement ce qui se passe. Et pourtant il se passe quelque chose, et pas rien. Il y a mort d’homme. Quand je dis que personne ne saura, c’est que Hermann lui-même, l’homme aux 25 écritures (!), se perdra dans ce dédale qu’il a en grande partie créé, d’autant qu’il a assez souvent, dans sa vraie vie, une impression de flou et d’irréalité qui l’étonne lui-même et ne l’aide guère à distinguer les souvenirs réels des autres. Ce que le lecteur se demande donc aussi.
Mais voilà que je ne vous dis toujours rien de l’histoire pourtant passionnante ! Alors disons : Hermann, homme d’affaire dont on ne sait plus s’il est riche ou pauvre, époux négligeant et méprisant d’une femme extraordinairement accommodante, fait aux premières pages de ce récit la rencontre fortuite d’un vagabond qui se trouve être son sosie. Il est absolument fasciné par cette incroyable ressemblance et cherche bientôt un moyen d’en tirer parti.
Ce qui arriva ensuite, c’est ce qu’il vous raconte lui-même dans ces pages s’adressant directement à son lecteur, à vous qui l’écoutez envoûté… sauf que vers la moitié du livre, pratiquement par hasard, vous découvrez qu’en fait, ce n’est pas à vous qu’il parle mais à la personne à qui il va adresser ces pages. Et cette personne est… je vous laisse le découvrir.
Hermann est un menteur, mais un menteur compulsif. Il ne peut pas se retenir. Il ment tout le temps, si bien que maintenant, il s’embrouille totalement, non qu’il y croie comme un mythomane, mais parce qu’il ne sait plus trop ce qu’il a dit à qui et quel rôle il doit jouer avec chacun. Son univers est ainsi devenu extrêmement instable et incertain. Mais il fonce quand même sans trop de crainte, certain ou à peu près, de toujours retomber sur ses pattes. Il faut vous dire qu’Hermann se croit très malin et manifeste une forte tendance à prendre les autres pour des imbéciles. Bientôt, dans ce labyrinthe, le lecteur, malin lui aussi, devine une issue imprévue, mais…
L’écriture de Nabokov est ici encore, d’une maîtrise extraordinaire. Il est impossible de ne pas l’admirer. Au sujet de La Méprise, après avoir « démoli » les commentaires des critiques professionnels (qu’il détestait de façon épidermique) Nabokov conclut: « Les lecteurs ordinaires, en revanche, se réjouiront de sa structure simple et de son intrigue plaisante. »
C’est vrai.
Mais néanmoins, rien n’est plus faux.
978-2070384020